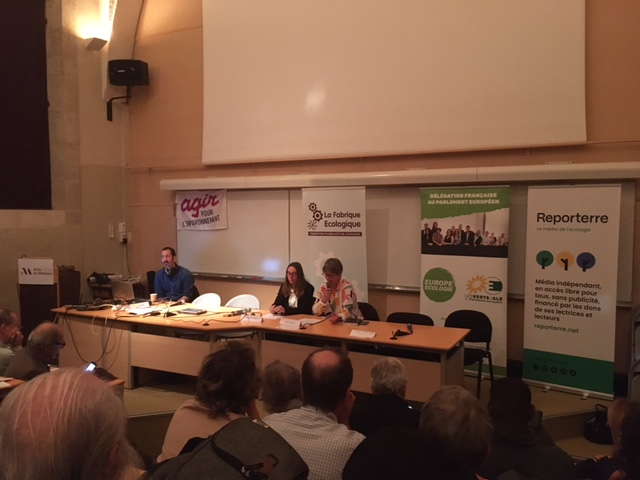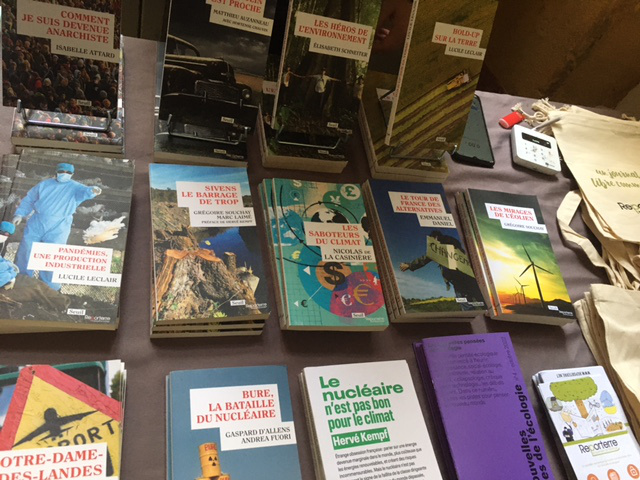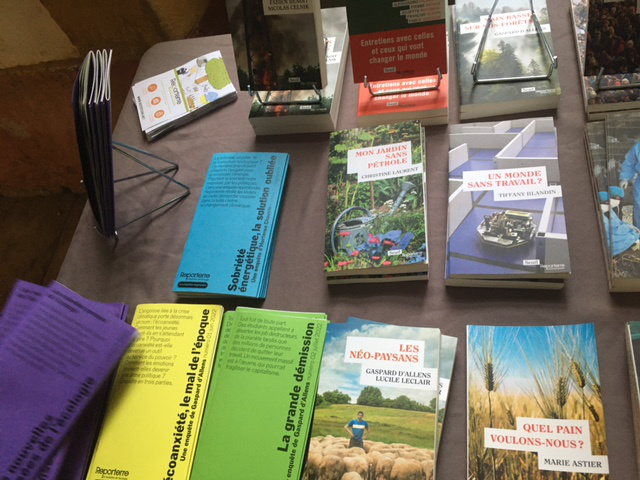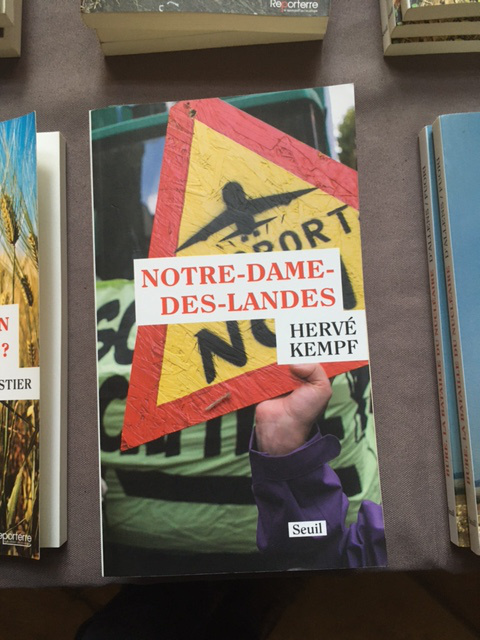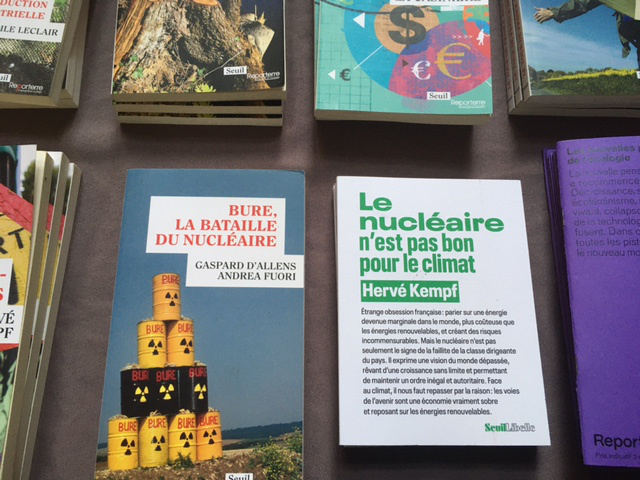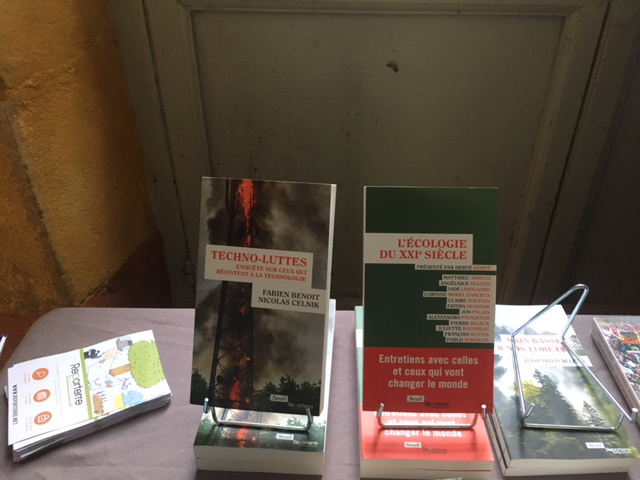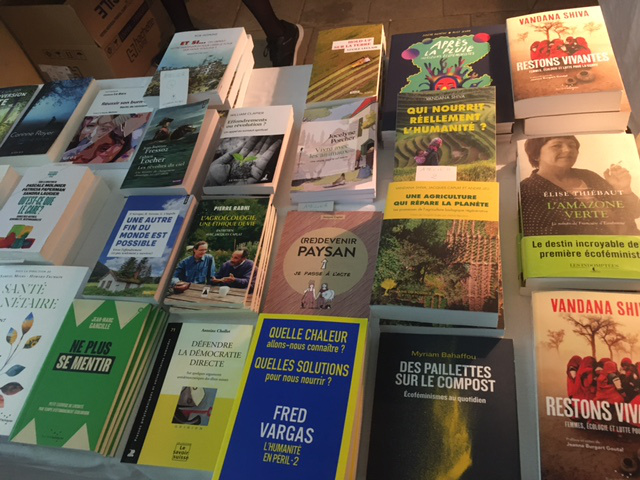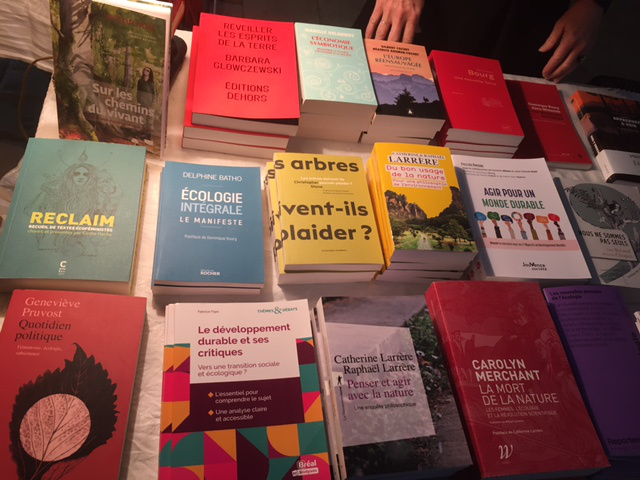|
Discours d'introduction de Claire Mallard

Mesdames messieurs, cher e s ami e s,
La fréquentation de ces rencontres dépasse nettement nos
attentes, probablement près de 400 participant.e.s et nous
vous prions vraiment de faire preuve d'indulgence pour les
problèmes d'organisation, en particulier l'accès à certains
ateliers qui risque d'être parfois compliqué.
Au nom du collectif l’instant d’après, collectif
d’activistes, d’élus et d’habitants du Mâconnais Clunisois,
j'ouvre avec grand plaisir ces rencontres que nous préparons
depuis plusieurs mois ici. Plaisir terni par le décès de
Bruno Latour, le plus bourguignon des penseurs de
l’écologie, à qui nous rendrons hommage tout le long de ces
deux jours.
Nos rencontres se tiennent dans un contexte particulièrement
tendu et anxiogène à l’échelle nationale comme à l’échelle
internationale .
Tout ce qui semblait établi et solide paraît ébranlé, des
habitudes de vie apparemment immuables sont chamboulées, la
pénurie devient possible dans des domaines, pour des
produits ou des services qui parvenaient à nous presque
automatiquement, comme hors sol, tellement nous en
interrogeons peu la provenance ou les conditions de
production. Le pétrole, l’électricité, l’eau. Des produits
alimentaires venus de loin ou de près, dont les prix
flambent parce que tout simplement leur production devient
aléatoire. L’idée que tout puisse s’arrêter en raison d’une
pandémie liée aux dérèglements du vivant ne relève plus de
la science-fiction. Sans compter les situations de
catastrophes climatiques qui présentent des factures
astronomiques aux particuliers comme aux États, surtout aux
populations les plus pauvres du monde entier, ce qui
constitue autant de facteurs à venir pour de nouveaux
désordres.
Nous pourrions nous féliciter d’avoir été les premiers à
lancer les alertes mais l’accélération des crises
écologiques, si elle peut causer de la sidération ou de
l’anxiété, ne produit spontanément aucun effet automatique
de réajustement.
Nous savons nous, que ces crises, qui se cumulent et se
combinent, impliquent (et rapidement) des ruptures
fondamentales avec la façon dont nos sociétés fonctionnent
depuis des dizaines d’années. Retrouver le lien avec la
terre et le vivant, habiter, travailler et consommer
autrement, interroger vraiment ce qui est indispensable et
ce qui l’est moins, c'est d'une immense métamorphose de
civilisation dont il est question.
Ces ruptures touchent aux formes de pouvoirs, de coopération
et de domination, à l'intrication des relations entre les
personnes, parfois à l'image que nous avons de notre place
dans la société. Nous devons nommer, désigner nos
adversaires et les obstacles, en appeler contre eux aux
soulèvements de la terre, sans pourtant appeler à la guerre
de chacun contre tous bien au contraire évidemment.
Nous devons montrer comment l’avènement d’une société
écologique, c’est à dire qui ramène l’économie au-dessous de
ce que peut supporter la Planète, peut nous faire vivre
mieux, mais nous avons mis tellement de retard à décrire
cette société écologique.
Nous devons agir ici, mais pas plus qu’il n’y avait de
socialisme dans un seul pays, il n’y a de vraies frontières
entre les écosystèmes.
Nous sommes des amis de la science et de la technique mais
nous n’aimons pas la façon dont elles sont embarquées par
l’extractivisme, l’économie coloniale de plantation et pour
tout dire par le capitalisme.
Et nous n’avons peur de rien : ni de parler de sobriété dans
une région viticole, ni d’en appeler à la baisse de la
consommation carnée en plein charolais, ni de vouloir sortir
du nucléaire à 50 kilomètres de là où l'on fabrique les
cuves d’EPR. De lenteur quand les gens ne s’arrêtent pas, de
droit à la paresse alors que certains ploient sous le
surtravail .
Car mème les mots peuvent nous jouer des tours.
Dans une situation inédite, nous ne pourrons pas dire les
transformations de l'avenir avec les mots et les seuls
imaginaires du passé. Mais nous savons aussi que les gens
raisonnent avec les mots qui leur sont familiers, ceux de
république, ceux de progrès, de travail voire de croissance,
ceux de nature ou d’environnement, qui appartiennent tous
aux vocabulaires des batailles antérieures.
C’est pour faire le point sur tous ces paradoxes que nous
avons souhaité ces rencontres.
Nous avons progressé et nos sociétés ont avancé également
depuis les débuts du mouvement écologiste.
Nous sommes cependant, comme elle, l’objet d'un pilonnage
intense des tenants de la nostalgie, de la fureur du tout
sécuritaire, de la désignation de toute sorte de boucs
émissaires. Une course de vitesse est ainsi engagée entre
une sortie humaniste des crises globales et une issue
barbare de la guerre et de la violence contre soi-même.
Au-delà des trajectoires diverses par lesquelles on y
arrive, dont témoigne la diversité des doctrines et des
concepts, nous avons en situation d’urgence, à peaufiner le
discours et l'imaginaire du futur écologique.
Comme dans la célèbre BD de l'an 01, on s'arrête et on
réfléchit. On n'a pas le temps de réfléchir mais on doit le
prendre quand même car si notre action est plus que modeste,
notre responsabilité est pourtant immense. Face au système
des dominations et des destructions massives, le repli sur
soi et l’idéologie national-populiste semble être le récit
protecteur qui rassure nos concitoyennes et concitoyens.
C’est bien ce temps historique dans lequel nous sommes
aujourd’hui et qui a motivé les membres de l’Instant d’Après
à ce que nous soyons réunis aujourd’hui ensemble.
Humblement, nous avons souhaité contribuer à poser des
fondations solides au renouvèlement des pensées écologistes
pour qu’elles soient désirées et désirables par le plus
grand nombre.
Nous n’allons pas en 48 heures bouleverser l’état des
connaissances, ni aller plus loin que bien des réunions
savantes.
Notre propos est modeste ! Contribuer à un premier état des
lieux ; baliser les controverses, les faire travailler
tranquillement, tout en pointant les plages de ce qui va
nous rassembler, pour aider la société à trouver en
elle-même les ressources, les voies et le pouvoir d’agir .
Vous êtes ainsi invité.e.s à participer à ces rencontres non
seulement pour l’intérêt que vous allez y trouver
personnellement, mais en vous demandant comment, en fonction
des situations que vous connaissez, vous pouvez faire
rebondir le débat et participer de l'effort commun pour
faire réseau.
Bonnes réflexions !
La restitution du contenu des tables rondes et ateliers se
focalisent arbitrairement sur certains ateliers et
certains propos que celui qui témoigne estime
significatifs - ou, tout simplement, a eu l'opportunité
d'entendre. A chaque fois, le témoin se s'interdit pas d'y
ajouter des compléments et commentaires. On s'efforce de
bien distinguer (en rouge)
la restitution et ces réactions - contestables, bien sûr -
à ce qui s'est dit, de sorte que vous avez tout le loisir
de ne pas les lire. Et encore une fois, si vous avez
assisté aux débats et souhaiter nous envoyer vos
compte-rendus complémentaires, vous êtes les bienvenus.
Table ronde d'ouverture
Quoi de neuf du côté des pensées de l'écologie ?
Intervenants: Lucile Schmid,
Catherine Larrère, Dominique Bourg, Marie Toussaint, Patrice
Maniglier, Fabrice Flipo (voir programme en pdf - lien en
début de page - pour les titres de chacun)
"Face à la nécessité de
changer, quelle portée attribuer au succès de concepts comme
la décroissance, la post-croissance ? La revendication de
rupture, de radicalité manifeste-t-elle le besoin d'un lien
fort entre pensée et action ? Comment penser ensemble les
différentes échelles, organiser une circulation ? Que nous
disent les initiatives locales d'une perspective planétaire
? La diffusion 'indisciplinée' de l'écologie - échelles,
secteurs - appellent-elle une perspective commune, voire des
'régulations' ? Comment penser le moment présent, tout en se
situant dans une continuité ?" (extrait du programme
détaillé fourni aux participants)
Ce qu'on a pu entendre
Parmi les présentations
générales, Jean-Luc Delpeuch
a insisté sur le parallèle possible entre le contexte de la
fondation de l'Abbaye de Cluny et le nôtre: époque de
guerres, d'instabilité, d'épidémies, d'inégalités, etc.
Claire
Mallard: "Nous avons souhaité contribuer à poser
des fondations solides au renouvellement des pensées
écologistes pour qu’elles soient désirées et désirables
par le plus grand nombre."
Dominique
Bourg est revenu sur trois thèmes clés de la pensée
écologique contemporaine:
1)
La décroissance.
Une
thématique qui serait apparue en France dans les années 70,
avant de s'internationaliser. Il a insisté sur le fait que,
pour tous les spécialistes de l'écologie, la "croissance
verte" n'est qu'un "mythe" engendré, entre autres choses,
par l'"économie de l'environnement". À l'échelle
internationale, on peut dire, selon lui, que tous les
spécialistes sont, plus ou moins, décroissants. On aurait
donc là une idée-force, qui traverse la pensée écologique
dans sa diversité. En témoigne le changement de discours de
l'Agence Internationale de l'Énergie sur la question.
Dominique Bourg parle de "changement du paysage
intellectuel" et renvoie à l'ouvrage La prospérité sans
croissance (2010).
Ajoutons
un point: Lewis Mumford, historien américain des
techniques, auteur de Technique et Civilisation en
1934, est une référence décisive dans la pensée française
des années 50 aux années 70. On le retrouve des notes de
lecture de Guy Debord jusqu'à des références élogieuses et
précises dans la Convivialité d'Ivan Illich.
Acteur majeur de la première critique de la société de
consommation, dans l'entre-deux guerre états-unien, il
plane sur toutes les critiques de la consommation et les
défenses corrélatives de la décroissance, de la pensée 68,
en France. Il fournit ainsi des concepts clés à cette
pensée: celui de seuil de contreproductivité ou encore
celui de mégamachine (un concept qui enveloppe à la fois
le développement technique et la bureaucratie, lorsqu'ils
dépassent leur seuil de contreproductivité). Ce rappel
n'est pas du snobisme intellectuel: il montre qu'articuler
critique de la consommation et décroissance n'est pas
apparu en cours de route - cette pensée accompagne la
société de consommation depuis ses tout débuts, aux
Etats-Unis. Y compris la critique de la publicité - dès
les années 10 aux USA -, ou encore le souci de la
protection de l'environnement - pas seulement les
nuisances des fumées de charbon en Angleterre, mais aussi
la protection des forêts (Théodore Roosevelt nomme un
secrétaire d'État aux eaux et forêts dans son
Administration, au tout début du 20e siècle). La société
de consommation est originairement contestée, et la pensée
écologique s'inscrit très tôt dans la continuité de cette
critique, y compris le concept de décroissance (dont on
retrouve l'idée chez Commons ou dans certains articles de
Keynes, dans les années 20, par exemple, même s'il semble
l'oublier ensuite...).
2)
L'effondrement.
Là
encore, on a affaire à un thème commun, si on laisse de côté
les versions caricaturales, comme celle d'Yves Cochet. On
peut clairement parler, selon lui, et tout le monde, à le
suivre, d'une "dynamique de délitement". Même si des
"commerciaux populistes" parcourent le monde pour estimer
les données scientifiques sans importance, et développer des
discours à géométrie variable, qui ne se fondent que sur
l'individu (typiquement: Macron comme référentiel ultime -
ce qu'il dit est vrai parce qu'il le dit). Parallèlement,
les pouvoirs qu'ils servent détruisent l'ONF, Météo France
et tous les services qui pourraient corroborer la réalité de
cette dynamique. De là une conclusion de Dominique Bourg: en
France le principal facteur d'effondrement, c'est le
gouvernement... De ce point de vue un Macron et un Trump
relèvent d'un même populisme.
Si
l'on suit ce diagnostic, il implique que le
climatoscepticisme n'est pas seulement une propagande,
c'est aussi un mode d'action, un programme. Comme si l'on
avait voulu nier l'existence des micro-organismes en
détruisant tous les microscopes. Un peu comme on nie la
pauvreté en détruisant les agences qui servent à l'étudier
et à en objectiver les conditions et les détériorations.
La domination passe aussi par une appropriation des modes
de production du savoir. De ce point de vue, la pensée
écologique relève de ce qu'on appelle aujourd'hui les
savoirs critiques.
C'est
aussi bien dire, deuxième point, que l'effondrement ne
serait pas forcément une dynamique autonome, qui vit sa
propre vie, une fois enclenchée: le délitement dont parle
Dominique Bourg n'a pas seulement des déclencheurs, elle a
des agents effectifs. Les réactions en chaîne et les
effets démultiplicateur mis en évidence par les sciences
ne peuvent être ignorées. Ils ne doivent pourtant pas
masquer cette dimension plus ordinaire mais tout aussi
redoutable des dynamiques de délitement.
3)
La sobriété impliquée par un changement de relation à la
nature.
Dominique
rappelle le rôle de notre meilleure compréhension, grâce aux
travaux de Clastres, Descola, et d'autres, de la variabilité
des relations humaines à la nature. Elle a contribué à
objectivité et mettre à distance celle qui caractérise la
civilisation industrielle. Cela a contribué à la
destabilisation mentale provoquée par ce à quoi nous ont
conduit nos anciens repères. C'est dans ce contexte qu'il
faudrait penser le besoin structurel de sobriété - bien loin
des discours du gouvernement.
Ce
n'est bien sûr pas sans rapport avec un point sur lequel
Dominique Bourg a insisté durant la discussion qui a suivi
les exposés: on ne change pas une société sans changer son
agriculture. La question posée, par un paysan, portait sur
la disparition progressive de la classe paysanne, et la
question cruciale pour lui de l'arbitrage entre la
recréation de cette classe, et une diffusion plus grande
des capacités d'auto-subsistance dans la population. Une
question qui avait le grand mérite, à mon avis, de
remettre au centre du problème de la sobriété la question
du meilleur mode de vie possible dans les conditions qui
sont les nôtres.
Marie
Toussaint a insisté sur le besoin, pour le
politique, de "muscler son discours", du côté des
écologistes. C'est un travail que le RN aurait su faire,
avec les résultats que l'on sait. L'affaire serait cependant
plus complexe pour la pensée et l'action écologiques, prises
dans des tensions internes qui font sa richesse et, pour le
moment, sa faiblesse dans la société. Tension entre
"réensauvagement" et promotion d'élevages respectueux, par
exemple. Besoin de loger dignement et lutte contre
l'artificialisation des sols. Autre difficulté, celle d'une
pensée en développement qui conduit nombre d'aspects à
exister de manière plurielle, et parfois confuse, avant même
de trouver un nom (ex. écoféminisme ou justice
environnementale). Dernier exemple, les désaccords autour de
l'exigence et du sens d'une rupture avec
l'anthropocentrisme. Faut-il lier ces trois dogmes:
croissance, souveraineté solitaire et anthropocentrisme ?
La 2e partie du propos a
insisté sur les actions auxquelles elle a contribué: la
judiciarisation des problématiques écologiques, qu'incarne
exemplairement la traduction en justice de l'État pour
inaction climatique, grâce à la pétition L'affaire du
siècle. En vu de créer une "jurisprudence de la
Terre", qui s'articule aux traités internationaux. La
justice, ici, ce n'est seulement une valeur, mais aussi,
plus pragmatiquement, un outil judiciaire mobilisable.
Elle a conclu sur
l'importance de cesser de stigmatiser les plus pauvres, en
opposant fin du monde et fin du mois, ou en parlant de
"seuil d'acceptabilité sociale".
Ce
qui rejoint, à mon avis, l'appel à une écologie désirable
(Claire Mallard) ou encore l'idée d'une prospérité sans
croissance (évoquée par Dominique Bourg). Dans la
discussion, Marie Toussaint le confirme: elle se méfie (et
à mon avis cela fait le grand intérêt de son propos et de
sa position) de trois attitudes: angéliser,
diaboliser, exotiser les représentations et les choix. Trois
manières de ne pas regarder en face la complexité. Exemple
qu'elle donne: on peut conspuer l'esclavage nécessité pour
faire des pyramide, ou le servage pour construire des
cathédrales, mais on ne "musclera" pas efficacement le
propos écologique, pour reprendre une expression qu'elle
utilise, si on nie que d'une manière ou d'une autre, il
faudra trouver les formes de grandeur nouvelles qui nous
sont possibles. Même si je me
méfie du mot "grandeur", c'est là une grande question
(sans aucun second degré...) !
Pour Fabrice
Flipo, entre autres choses, le développement des
pensées écologiques aujourd'hui ne relève pas d'un effet de
mode, comme dans les années 70 ou 90.
Je
ne vais pas plus loin, tant cela me semble problématique.
Au mieux, il y a là une ignorance: celle de l'effet du
développement des technologies numériques qui ont provoqué
un surcroit de mise à distance des dommages
environnementaux, au cours des années 80 (qui ont connu
aussi bien un refoulement des pensées 68 - y compris sur
le plan écologique - qu'exemplifie parfaitement un Luc
Ferry). Et que dire de l'ignorance complète de
l'écrasement, par les forces de l'ordre, des mouvements
altermondialistes - porteurs importants de l'écologie - au
tournant des 20e et 21e siècles ? Il n'y a là aucun effet
de mode, qui aurait précédé une conscience écologique
sérieuse et très récente, mais une lutte de longue
haleine, et ne pas le voir masque les effets de domination
culturelle et policière exercés à l'encontre de la pensée
et de l'action écologiques - en décliner les exemples
ferait exploser le stock de mémoire disponible pour ce
site...
Catherine
Larrère est partie d'une typologie des manières de
secondariser la question écologique. Deux manières d'en
minimiser la nouveauté: 1) la "sectorialisation": en plus de
l'économique et du social, il faudrait ajouter maintenant un
troisième secteur d'action, l'environnemental - au
contraire, malgré ses défauts, la notion d'anthropocène a au
moins le mérite de pointer la globalité de l'enjeu
écologique; 2) l'assimiler à des grands problèmes déjà
rencontrées - typiquement la question sociale du 19e siècle.
Les comparaisons entre ces deux questions sont le plus
souvent trompeuses. Exemple type de différence, pourtant: la
question sociale a massivement conduit a une demande d'État,
là où la question écologique va souvent de pair avec une
demande de démocratie. Une différence à prendre en compte.
Autre point majeur: la question écologique a conduit à des
bouleversements conceptuels plus profonds, en marquant la
fin d'une opposition tranchée entre nature et culture. Mais
à partir de là, conclut-elle, tout reste à (re)penser, et
l'on ne peut tirer que peu de ressource du passé pour y
parvenir. "On ne résout pas des problèmes avec les modes de
pensée qui les ont engendrés".
Quelques
réserves pour creuser, ou questions que j'aurai voulu
poser. La distinction tranchée Nature/Culture a-t-elle
attendu la crise écologique pour être remise en cause ?
Voire - si je provoque un peu - n'a-t-elle jamais existé
ailleurs que dans l'esprit de quelques intellectuels
occidentaux des 19e et 20e siècles ? Pour en rester au
plus évident. Le darwinisme a déjà conduit à reconfigurer
en profondeur les rapports entre nature et culture,
jusqu'à ne plus en faire une distinction, puisque ces
concepts ne jouent pas sur le même plan - il se trouve que
certains animaux ont dans leur nature la disposition à
produire une culture. Toute l'anthropologie et la pensée
pragmatique américaine en sont imprégnés depuis le tout
début du 20e siècle, parlant en termes d'interactions
(environnement/espèces ou individus, ou entre espèces,
entre individus, etc.). La vraie question, peut-être, est
de savoir comment, face à la crise écologique, on traite
ce qui spécifice les humains: une dénaturation ? Une tare
? Une puissance nuisible ? Difficile de regarder en face
la crise écologique sans céder à la haine de soi, et c'est
tout le problème... Il faudrait creuser, mais ce n'est pas
sans rapport avec la question qui me semble plus
importante: pourquoi la crise écologique conduit, chez
ceux qui l'assume pleinement, à une exigence de
démocratie, plutôt qu'à une demande d'État ? Est-ce
seulement parce que l'État a failli dans cette tâche ? Pas
sûr.
Atelier 6
Marché, capital, propriété, biens communs
Intervenants: Ludovic Martin,
Guillaume Duval, Mireille Bruyère (voir programme en pdf -
lien en début de page - pour les titres de chacun)
Ce qu'on a pu entendre
1e échange
Ludovic
Martin commence par rappeler ce que seraient les
trois grandes secteurs de l'économie aujoud'hui: le secteur
de l'entreprise, les services publics et le champ de
l'économie sociale et solidaire (ESS). Quel statut pour ce
troisième secteur ? Est-ce la béquille ou le complément des
deux autres, ou bien vient-il "détricoter" les deux premiers
?
Pour Mireille
Bruyère, cette approche est trop schématique. Le
mouvement associationniste est à l'origine du mouvement
ouvrier: dès le début du 19e siècle, des ouvriers cherchent
à s'associer "dans un objectif de démocratie au travail".
Ensuite seulement, le mouvement se déporte sur des questions
de répartition du produit pour devenir un salariat protégé
par l'État. Lorsqu'on assiste à un renouveau du mouvement
associatif, dans les années 70, il n'a le plus souvent pas
pour visée de créer des collectifs de travail. Les premiers
mouvements associatifs étaient anti-capitalistes. Le second
vise massivement la protection des exclus. L'ESS,
aujourd'hui, reste en tension entre une exigence de
démocratie au travail et une demande de protection publique.
Pour Guillaume
Duval, la manière dont la gauche aborde la question
est "stupide": ce qui compte ce sont les interactions entre
ces trois champs. "Il faut de tout pour que cela
fonctionne". La division du travail accroit les biens
disponibles, mais fragilise la société. Cela crée un besoin
de "biens publics": sécurité, santé, éducation. Comme Keynes
l'a formulé, l'activité capitaliste a besoin de ces biens
pour fonctionner - ce que la plupart des discours publics
des chefs d'entreprise semblent pourtant nier, à tort.
Assurer ces biens publics conduit cependant à produire un
appareil bureaucratique qui pose problème. De là le besoin
de ce tiers secteur.
Manifestement,
la manière dont Guillaume Duval décrit les choses passe
sous silence (comme tous les discours organiciste) les
tensions et les conflits, que, au contraire, Mireille
Bruyère souligne - ce qu'elle développe dans le 2e
échange.
2e échange
Ludovic
Martin: Qu'est-ce que la crise écologique vient
bousculer dans ces trois champs ?
Pour Mireille
Bruyère, le capitalisme vise, par nature,
l'accumulation: il ne peut pas être écologique. Et, d'autre
part, le public ne garantit pas la résolution de la crise,
d'autant que, depuis la révolution managériale et les
théories du Public Choice, le service public, lui-même,
devient productiviste. Si l'on veut rompre ce cycle, il faut
défaire ces cohésions, et repartir de la question des modes
de production.
Lors de la discussion,
quelqu'un reviendra sur cette tension entre entreprise
capitaliste et objectif de décroissance.
Quelques
explications.
Ce
qu'on appelle théorie du Public Choice est un champ
de l'économie qui se développe depuis les années 60,
notamment initié par l'économiste James Buchanan. Il
s'agit de produire des instruments de décision et
d'arbitrage des interventions publiques fondés sur des
critères strictement économiques. On part d'un constat
établi déjà par Milton Friedman: l'État intervient pour
corriger les failles de marché et les dommages collatéraux
de l'économie de marché. Mais cette intervention a un coût
et engendre ses propres failles et ses propres dommages
collatéraux. La décision d'intervention doit être capable
de prendre en compte rationellement tous les bénéfices et
tous les coûts. Ce qui conduit souvent à laisser faire les
failles de marché de "peur" que les failles publiques
soient plus importantes.
La
révolution managériale tient à l'importation, dans
l'administration publique, de ce qu'on perçoit comme étant
les modes de gestion des ressources humaines et
matérielles efficaces du monde de l'entreprise. Amorcé au
cours des années 70, ce mouvement repose sur l'idée plus
générale d'importation des meilleures pratiques,
qu'elles viennent du monde de l'entreprise ou des pays
étrangers, sans tenir compte des spécifités nationales ou
de supposées spécifités de l'action collective publique,
par rapport à l'action collective privée. Les limites
souvent soulignées tiennent à une forme d'atomisme (=
possibilité d'évaluer une pratique abstraction faite de
son contexte de mise en oeuvre), qui présuppose l'absence
de spécificités de l'action publique ou l'absence de
pertinence de l'évaluation du contexte dans lequel une
pratique est mise en oeuvre.
Ces
deux approches expliquent l'usage le plus fréquent (et en
réalité perverti) de l'injonction au pragmatisme dans les
décisions publiques. Dans tous les cas, elles conduisent à
prioriser les critères économiques dans les prises de
décisions (y compris lorsqu'il y a conflit de normes au
niveau juridique - voir les développements plus récents de
Richard Posner). De là la tension de fond que Mireille
Bruyère souligne entre ces deux évolutions et l'ambition
écologique.
Guillaume
Duval rappelle que les économies administrées ont
été les plus polluantes de l'histoire. Les hauts niveaux de
consommation, dans un pays comme le nôtre, tiennent à
l'égalisation des conditions: la consommation des plus
riches crée un besoin de consommation des plus pauvres qui
connaissent celle des plus riches (il évoque Thorstein
Veblen et la théorie de la consommation ostentatoire).
La
théorie de la consommation ostentatoire visait à
expliquer, par des motifs socio-psychologiques, les
dépenses, apparemment improductives, qui se développent à
grands pas aux États-Unis au moment de la naissance de la
première société de consommation. Ces consommations sont
en réalité productives en termes de statut social, donc de
pouvoir. Veblen développait cette grille d'analyse, dans
les années 1910, avec une visée critique relativement
forte.
3e échange
Ludovic
Martin: quelle est la place des citoyens ou des
salariés dans le future pour produire un modèle soutenable ?
Mireille
Bruyère préfère répondre aux derniers propos de
Guillaume Duval, et rejette l'idée que la montée de la
consommation des plus pauvres soit responsable de la crise
écologique. Il faut s'interroger plutôt sur la destruction
des conditions matérielles de l'autonomie des gens (qui a
commencé avec les enclosures). Il y a certes depuis les
années 60, une massification de la consommation. Mais
corrélativement, on assiste à une hausse, dans les classes
moyennes, de la part des dépenses contraintes et inutiles en
valeur d'usage. Face à cela, moraliser la consommation n'est
pas efficace. S'en tenir à la position défendue par
Guillaume Duval peut conduire à un appel à contraindre la
consommation des plus pauvres.
Là
encore, quelques explications. Mireille Bruyère fait fond
sur des analyses présentes, par exemple, chez Ivan Illich
(qu'elle mentionne par ailleurs), mais qu'on retrouve dans
nombre de critiques de la société de consommation depuis
le début du 20e siècle. Son développement n'est nullement
l'effet spontané des désirs de chacun ou des rivalités
mimétiques. Il tient d'abord à la transformation des
conditions matérielles de vie, qui conduit à réduire
toujours davantage l'autonomie des individus en matière de
besoins élémentaires - s'alimenter, se protéger, se
déplacer. Et ce par la division du travail (qui spécilise
les compétences au point de rendre inapte la plupart des
gens aux tâches que requérerait un minimum d'autonomie) et
la constitution d'une classe 'nourrissière' (qui produit
les aliments du reste de la société). Le rallongement des
distances est un autre lieu de création de besoin, dont
l'explication ne repose pas sur des mécanismes
psychologiques. Tout cela conduit à l'accroissement des
"dépenses contraintes" dont elle parle.
Pour Guillaume
Duval, le problème principal tient au
court-termisme politique des démocraties, lié aux enjeux
électoraux. Si, au contraire, on parvient à imposer un cadre
stable, prévisible, les entreprises s'adapteront. Mais c'est
difficile dans un contexte démocratique. Le risque est que,
si on n'y parvient pas, certains soient conduits à l'idée
qu'on a besoin de dictature. On l'a déjà connu concernant la
question sociale (dictature du prolétariat).
Lors de la discussion,
quelqu'un rappelle la position de Bruno Latour: parvenir à
imposer l'idée qu'au-dessus des intérêts de nations ou de
classes, il y a des intérêts communs planétaires. Faute d'y
parvenir, on risque le pire: le tribalisme, les replis
identitaires, etc.
Réponse de Mireille
Bruyère: le problème de l'idée de biens communs
planétaires tient aux institutions qui seraient supposées
devoir les gérer et les garantir. Si, par ailleurs, la
question du local a, jusqu'ici, été préemptée par
l'extrême-droite, ce n'est pas une fatalité. Dans les années
70, le local était plus une thématique bien à gauche.
Ailleurs, dans la discussion, elle revient sur cet enjeu de
la taille, des seuils, et évoque Ivan Illich.
Je
me permets de rapporter ma propre intervention. Dans les
propos de Guillaume Duval, on reconnaît nombre de motifs
connus dans les pensées économiques et juridiques du 20e
siècle: une description de l'émergence des biens communs
que l'on trouve chez Walter Lippmann, une insistance sur
l'institution d'un cadre de prévisibilité soustrait aux
atermoiements démocratiques (théorie de la démocratie
limitée pour être durable - Walter Eucken, Friedrich
Hayek, Milton Friedman, Walter Lippmann, à nouveau), le
caractère déficient du jeu démocratique et de son
court-termisme (c'est la théorie de la démocratie comme
marché structurellement déficient, chez James Buchanan).
Et on peut ajouter deux points de l'intervention appuyé
sur Bruno Latour: 1) l'appel à l'institution
internationale de biens communs (dans un sens qu'on
retrouverait aisément chez Hayek, à nouveau); 2) la menace
des replis identitaires comme réflexe spontané face aux
difficultés (cela renvoie à la théorie lippmannienne des
stéréotypes - on rappellera que Lippmann invente ce
concept et que Bruno Latour était traducteur et grand
admirateur de Lippmann). Or, tous ces noms relèvent de la
tradition néolibérale, telle que la recherche académique
s'efforce de la reconstituer ces vingt dernières années.
D'où une question: comment se fait-il qu'une bonne part
des réflexions écologiques ne parviennent jamais à
s'abstraire du mode néolibéral de gouvernement ?
Guillaume
Duval: "oui, néolibéralisme, gnagnagna". Texto... Les
enfants, y a du boulot...
Atelier 12
Invitation
à la sobriété
Intervenants: Stephen
Kerckhoves, Bruno Villalba, Sylvie Landriève, Valérie
Guillard (voir programme en pdf - lien en début de page -
pour les titres de chacun)
Ce qu'on a pu entendre
Stephen
Kerckhove commence par quelques éléments,
pèle-mêle.
Nous serions en situation un
peu schizophrène: les "destructivistes" nous parle de fin de
l'abondance, de sobriété, mais le font en intériorisant
l'idée que cela relèverait d'une démarche individuelle.
"On arrête tout, on
réfléchit, et c'est pas triste". Ce fameux slogan tiré de la
BD de Gébé, L'an 01, parue en feuilleton entre 1971
et 1974, et repris, entre autre, par François Ruffin pour en
faire la maxime d'un blog.
Les 8 scénarios d'évolution
de la consommation électrique proposés par RTE: aucun
n'implique une baisse de consommation.
Bruno
Villalba distingue deux référentiels pour
développer la question de la sobriété.
Un premier renvoie à une
tradition de pensée: celle de la juste mesure dans l'usage
d'un produit - en présupposant qu'il peut être à disposition
sans limite. C'est une problématique du mésusage et de la
dépendance, que l'on trouvait déjà chez les Épicuriens, les
Stoïciens ou les Cyniques, pensant de différentes manières
la modération des usages. On retrouverait quelque chose de
similaire dans les monothéisme, mais, non plus dans une
réflexion sur la vie bonne, plutôt en réponse à une ou des
injonctions. Cela renverrait à la fois à l'idée d'une
frugalité sans renoncement et à un idéal de jouissance
modérée.
Une autre perspective serait
celle de l'écologie politique, à partir des années 70,
lorsqu'on constate un décrochage entre l'extension du
pouvoir technique et les ressources disponibles. On voit
clairement que, de ce point de vue, la sobriété ne peut être
ramenée à une démarche individuelle. Au regard des questions
classiques de justice distribution (question de la
répartition des richesses disponibles), cette situation pose
des questions spécifiques, liées à la temporalité de
l'urgence et à la globalité de la question (elle touche tous
les intérêts): elle se formule comme une politique de
renoncement et de répartition, non des richesses, mais des
efforts.
Sylvie
Landriève a tourné sa contribution vers les
propositions - contrebalancer la perspective de
l'effondrement. Sa méthodologie part d'un critère pour
parler de "sobriété heureuse": une sobriété choisie
collectivement. Ce qui suppose de se doter d'enquête pour
identifier ce que les individus sont susceptibles de choisir
collectivement (vieillir en bonne santé, ralentir, plus de
proximité, conserver son cadre - hormi pour les habitants
des mégalopoles). A partir de là, il serait possible
d'articuler une politique des transports écologiquement
vertueuse et socialement consentie.
Valérie
Gaillard part du marketing,
et d'un travail sur les pratiques des consommateurs
(approche psychologique) pour comprendre quelles sont
les freins à la perspective d'une sobriété. A commencer
par la difficulté, en général, de passer d'un mode de
vie à un autre. Dans le même temps, il est possible de
dégager les ressorts susceptible de motiver pour une
sobriété qui tournerait autour du "faire", en lieu et
place du "laisser faire" et du "faire faire", qui peut
rencontrer le manque de sens que ressentent beaucoup de
gens (notamment les jeunes) dans leur travail.
Atelier 13
Travail, activité, revenu
Intervenants: Jacques
Archimbaud, Antonella Corsani, Yann Moulier-Boutang,
Guillaume Allègre (voir programme en pdf - lien en début de
page - pour les titres de chacun)
Atelier 14
L'écologie est-elle sans frontière ?
Intervenants: Jean-Luc
Delpeuch, Chloé Ridel, Françoise Diehlmann (voir programme
en pdf - lien en début de page - pour les titres de chacun)
Table ronde finale
Désertion, rébellion, alternatives, désobéissances,
institutions
Intervenants: Géraud Guibert,
Lola, Stacy Algrain, David Cormand, Priscillia Ludosky,
Magali Payen (voir programme en pdf - lien en début de page
- pour les titres de chacun)
Reporterre
"Le Jardin Secret" (librairie, Cluny)
|
|